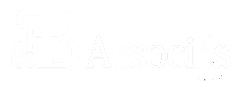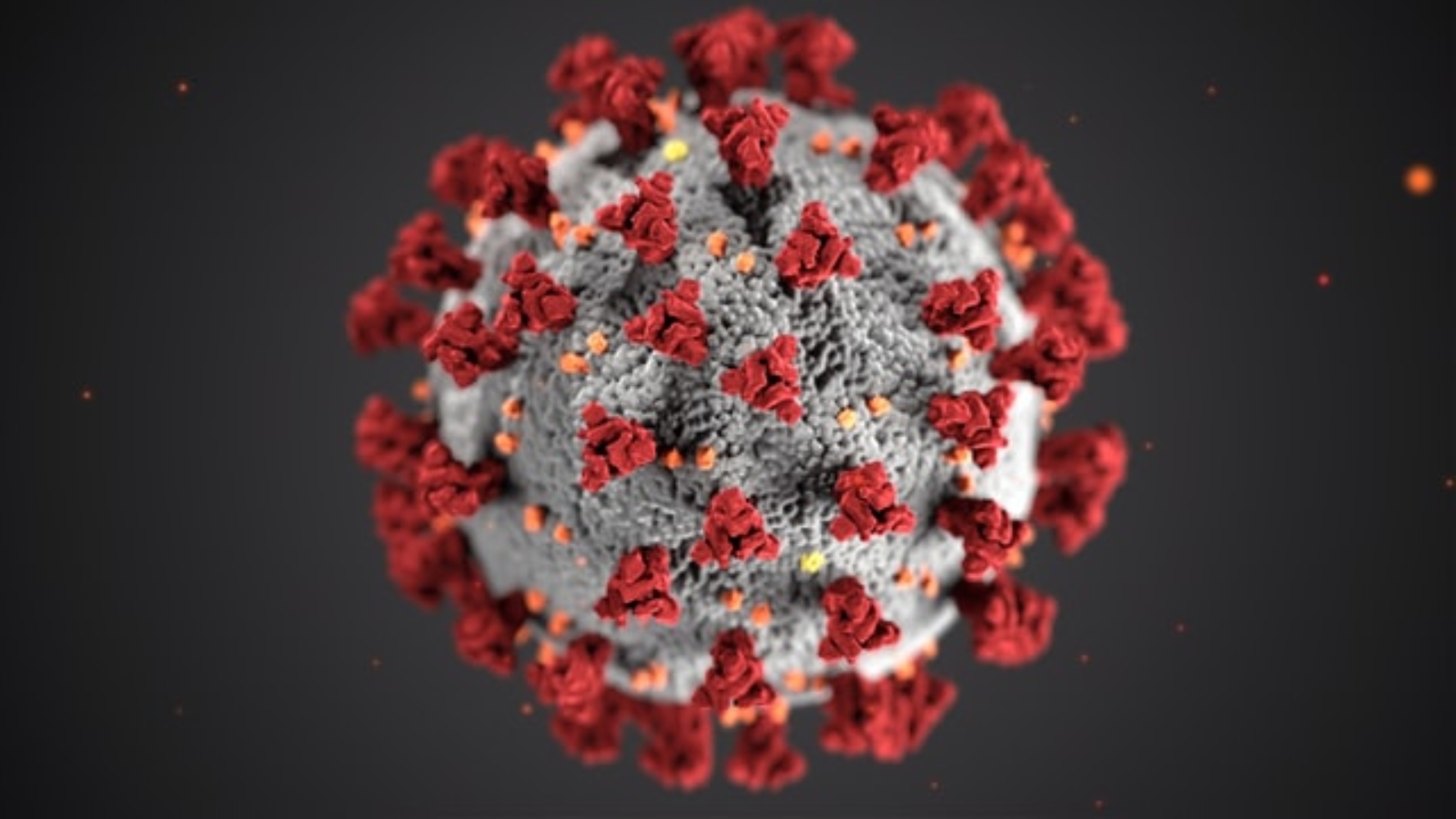Cet article a vocation à vous permettre de procéder à une première analyse d’un trop perçu qui vous serait appliqué et définir les premières démarches qu’il convient d’envisager. Nous vous invitons à prendre connaissance des deux premières parties relatives à l’évolution juridique de cette notion, qui demeure, à ce jour, très mouvante en juridprudence.
1. Identification du trop-perçu :
La définition du trop-perçu nécessite l’identification de trois critères cumulatifs :
– le versement d’une somme d’argent par l’Etat ou un établissement public à un particulier ou un fonctionnaire:
Que ce soit du salaire, une indemnité ou une allocation, la puissance publique a la faculté d’appliquer un trop perçu dès lors qu’il s’agit d’une somme d’argent. Ainsi, a contrario, elle ne peut pas appliquer un trop perçu pour compenser un avantage autre que financier qu’elle estimerait avoir attribué de manière indue ou pour s’octroyer une indemnité ou une compensation financière. Ainsi, par exemple, les trop-perçus sur rémunération venant compenser l’attribution indue d’un logement de fonction, sont illégales. Une telle créance nécessitera l’application d’un texte spécifique, par exemple, pour une indemnité d’occupation du domaine publique (Article L2125-1 du CG3P).
– la démonstration du caractère indu de ce versement
Le caractère indu peut résulter d’une erreur de l’administration, d’une fraude ou d’une négligence du fonctionnaire dans la déclaration de sa situation personnelle ou professionnelle, ou encore d’une décision parfaitement légale mais dont les effets sont rétroactifs sur la situation de l’intéressé. C’est le cas notamment des décisions constatant la consolidation de l’état de santé d’un fonctionnaire qui peuvent avoir pour effet d’annuler rétroactivement un CITIS ou un congé spécial à plein traitement versé sur plusieurs années. Le caractère indu du versement ne résulte pas de la cause du versement mais de l’absence de fondement juridique justifiant le transfert d’argent public.
– la création par l’Etat ou un établissement public, d’une créance à l’encontre du particulier ou du fonctionnaire pour obtenir restitution de cette somme
La décision d’appliquer un trop perçu peut prendre trois formes différentes :
a. Elle peut tout d’abord être directement appliqué sur le bulletin de paye, sans aucune autre forme de notification. Très souvent, une telle pratique manque de clarté et peut même passer totalement inaperçu tant les fiches de paye peuvent être complexes. L’application directe d’un trop perçu sur le salaire est toujours une décision administratif attaquable en justice, même si elle n’est pas motivée et que les voies de recours ne sont pas notifiées. Dans ce cas, la retenue sur la paie ne peut pas dépasser la portion saisissable de la rémunération de l’agent.
b. Le trop perçu peut également résulter de l’émission d’un titre de créance. C’est alors par l’intermédiaire de sa trésorerie que la personne apprendra sa dette.
c. Enfin, le plus souvent, le trop perçu sera notifié à l’intéressé par un courrier ou un arrêté, sans pour autant que cela ait immédiatement de conséquence sur la paye. Attention, dans ce cas, les délais de recours contre la décision courent à compter de la notification et non de l’exécution du trop-perçu.
2. Qualification du trop-perçu :
Question : Mon trop-perçu concerne-t-il une rémunération, principale ou accessoire ?
Si OUI, question : Suis-je à l’origine de l’indu (ex : oubli de donner une information à l’employeur) ou l’erreur est-elle due à mon administration (ex : mauvais calcul d’une prime par le comptable) ?
Si je suis responsable de l’indu : la prescription est de 5 ans.
Si l’employeur est responsable de l’indu : la prescription est de 2 ans.
Deux cas spécifiques rendent l’avantage définitif :
– Si la rémunérations versées à tort à des agents sur la base d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation par le Conseil d’État.
– Si la rémunération a été versée à tort sur la base d’une décision irrégulière devenue définitive de nomination dans un grade (avancement de grade, promotion interne ou titularisation d’un agent qui ne remplit pas les conditions – ces décisions sont en effet créatrices de droits et deviennent donc définitive si l’administration ne les retire pas dans le délai de 4 mois).
Si NON, question : l’indu est-t-il lié à un droit acquis (trop perçu est nul et l’avantage est définitif au-delà de quatre mois) ou à une simple erreur dans la liquidation d’une créance (prescription 5 ans)?
Si l’avantage résulte d’un acte juridique dont les conditions sont toujours en vigueur (pas de changement de situation) où dont la remise en cause est uniquement liée à la rétroactivité d’une décision de l’administration, il y a de grande chance que l’indu puisse faire l’objet d’une annulation par le juge administratif.
S’il n’y avait pas d’acte juridique, ou si les conditions initiales ayant présidées à l’octroi de l’avantage ne sont plus remplies, il s’agira alors d’une erreur de liquidation d’une créance.
Attention ! L’ensemble de cette analyse ne concerne que le délai de prescription de l’assiette, pas les délais de prescription de l’action en recouvrement. Cette dernière, opposable au comptable public, est de quatre ans à compter de l’émission du titre de recette.
Que faire en cas de trop perçu prescrit ou illégal ?
1) Ne pas payer immédiatement (dans la mesure du possible) car il est toujours plus facile de resister à une obligation de payer que d’obtenir le remboursement d’un paiement.
2) Ne pas demander d’échéancier, de délai ou de remise gracieuse, avant d’avoir examiné la légalité du trop-perçu. Celà reviens à admettre sans discussion de bien-fondé de la dette.
3) En cas de trop perçu non motivé : Demander par lettre recommandé A/R les motifs du trop-perçu.
4) Ecrire un recours graçieux ou hiérarchique le plus tôt possible par lettre recommandée A/R, et envisager un recours en annulation et un référé suspension. Le délai de recours est de deux mois si l’administration vous a informé des voies de recours, et d’un an en cas de défaut d’information (jurisprudence dite “CZABAJ”).
5) Envisager la question d’un recours indemnitaire pour négligence dans le recouvrement des créances publiques. C’est ce que nous verrons dans la dernière partie de cette série d’articles consacrée aux trop-perçus. La négligence de l’administration dans le recouvrement des trop-perçus peut donner lieu à une indemnisation, qui vient se compenser avec la dette du fonctionnaire de manière partielle ou même totale.
En cas de question complémentaire ou de litige concernant le droit de la fonction publique, Me Baronet et son équipe vous reçoivent ou répondent à toute sollicitation déposée sur cette plateforme ou sur https://fbassocies-avocats.fr/ dans les meilleurs délais.